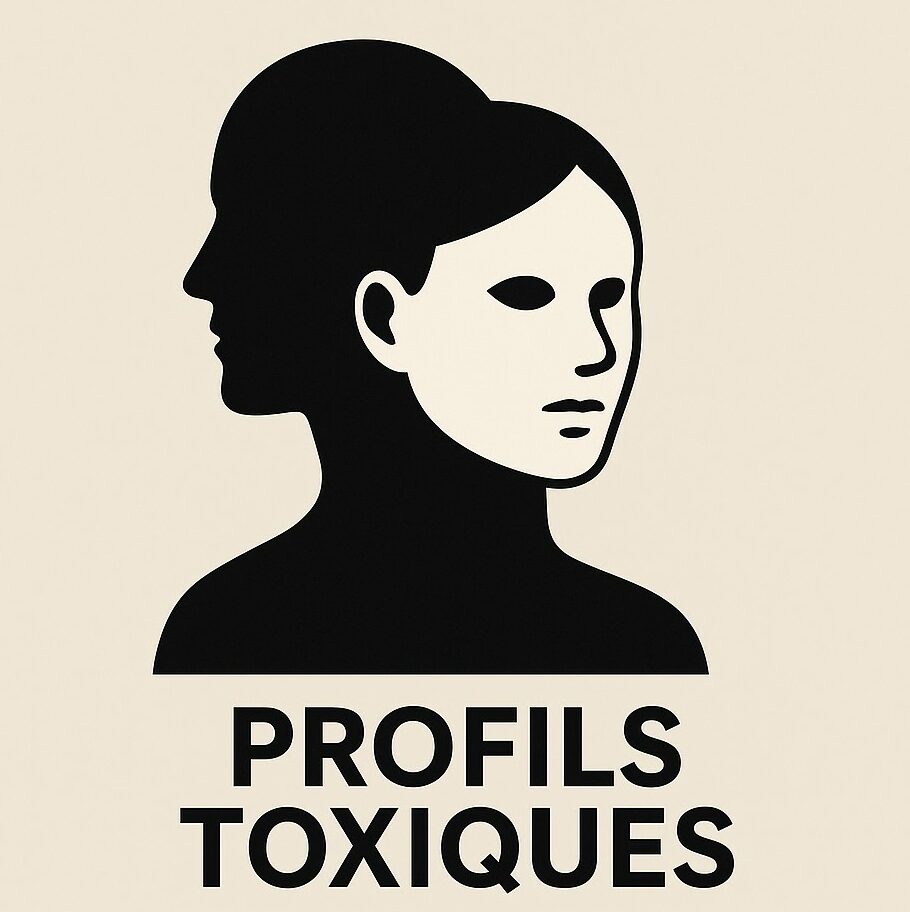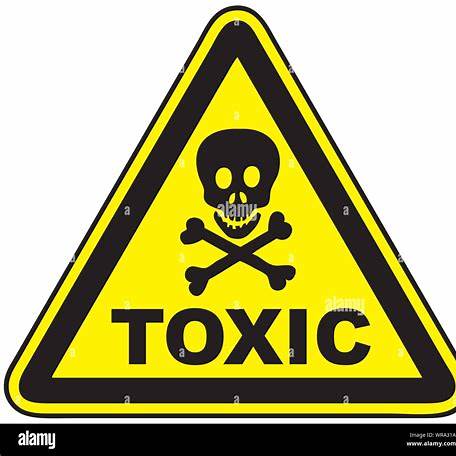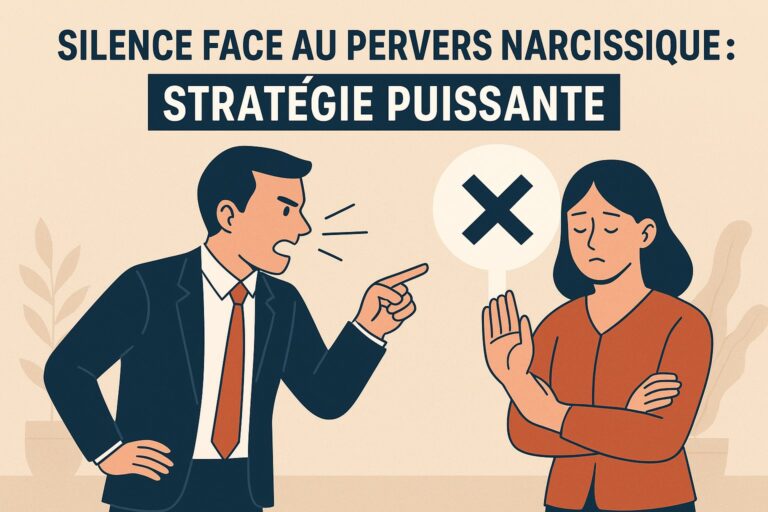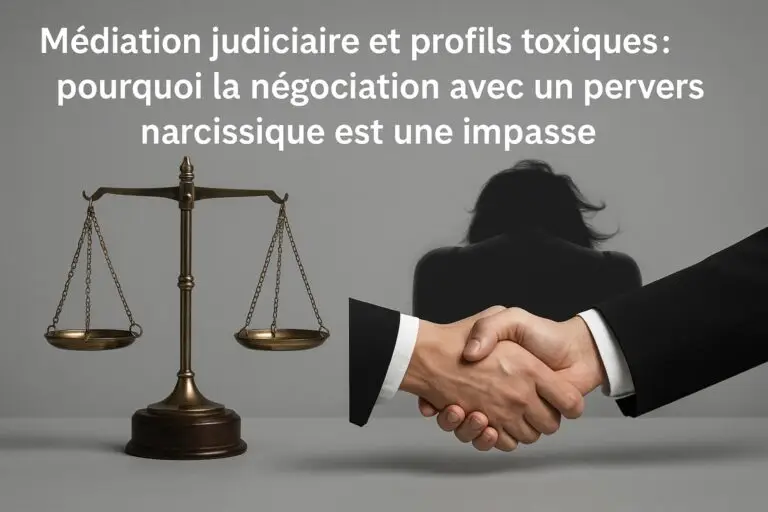Enquête harcèlement : le serpent de mer du pervers narcissique
La phrase « c’est un pervers narcissique » est devenue un classique dans les plaintes de harcèlement. Elle véhicule une émotion, une accusation morale, mais dans le cadre d’une enquête (disciplinaire, administrative ou judiciaire), elle peut devenir un piège. L’article “Enquête harcèlement, Le serpent de mer du ‘Pervers narcissique’” relève qu’en dépit du soulagement que procure ce mot pour les victimes, il devient un obstacle à la neutralité et à l’objectivité des enquêteurs.
1. Le mythe du « pervers narcissique » dans le vocabulaire courant
Origines et popularisation du terme
Le concept de perversion narcissique remonte aux travaux de Paul-Claude Racamier (années 1950), qui l’utilisait dans le cadre psychanalytique pour décrire des dynamiques relationnelles pathogènes. Par la suite, l’ouvrage de Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, a largement contribué à diffuser cette notion dans le grand public, en la liant aux souffrances invisibles du harcèlement. Aujourd’hui, elle est massivement reprise dans les médias, forums, réseaux sociaux, souvent comme étiquette pour des relations “toxiques”.
Une catégorie “psychologique” versus la démarche juridique
Le problème est que cette notion n’est pas reconnue comme un trouble diagnostic officiel par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ni par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l’American Psychiatric Association. C’est une construction théorique appliquée aux relations interpersonnelles, et non une infraction ou un élément de preuve juridique. Ainsi, sa mobilisation dans un cadre d’enquête peut brouiller la frontière entre la souffrance psychique ressentie et les faits objectivables.
2. Enquête de harcèlement : les obstacles quand le PN est invoqué
Dans un contexte d’enquête, qu’elle soit en entreprise ou auprès des autorités, invoquer le profil de PN va souvent détourner l’attention des faits vers des interprétations psychologiques. Trois écueils majeurs se manifestent.
Le biais de confirmation et la prophétie auto-réalisatrice
Une fois l’étiquette “pervers narcissique” posée, tous les comportements, même ambigus, seront interprétés dans ce sens : penchant vers la malveillance, intention cachée, manipulation, etc. L’article principal parle de ce qu’il appelle “prophétie auto-réalisatrice” : l’accusation incite la victime à voir dans chaque geste de l’agresseur la confirmation de sa thèse, et à les interagir en conséquence. Cela déforme le récit, polarise les parties et peut pousser l’auteur présumé à réagir “comme un pervers” — réaction qui sera reçue comme preuve.
L’écueil de l’interprétation psychologique
Lorsqu’un enquêteur (RH, inspecteur, magistrat) adopte un vocabulaire psychologique sans base d’expertise, il peut glisser dans l’affirmation : “ce comportement est typique d’un PN, donc c’est un harcèlement”. Cela revient à substituer un jugement de psychologue à l’analyse des faits concrets (emails, réunions, témoignages). L’article souligne que les enquêteurs doivent résister à cette tentation, pour ne pas « négocier avec un mythe ».
Responsabilité, éléments factuels et neutralité
Si l’auteur est “juste un malade”, on fragilise la responsabilité juridique. Pire, l’employeur ou l’institution enquêteuse pourrait être amenée à dire que le comportement relève d’une pathologie hors de son contrôle. L’article souligne le risque de faire du coupable un être “innocent” de ses actions si l’on s’en tient à une vision purement psychologique. Ces interrogations montrent bien que pour mener une enquête bien fondée, il faut rester centré sur les éléments objectivables et tangibles — indépendamment de la classification psychologique.
3. Se recentrer sur les preuves tangibles : la méthode rigoureuse
Pour qu’une enquête ait une chance d’aboutir, elle doit s’appuyer non sur des jugements, mais sur des éléments factuels recevables. Voici quelques pistes.
Types de preuves recevables
- Courriels, messages écrits, notes internes, historiques de réunions
- Comptes rendus, procès-verbaux, annotations
- Témoignages écrits ou oraux de tiers (collègues, témoins)
- Enregistrements audio / vidéo (dans les limites légales)
- Rapports psychologiques / médicaux (certifiant un lien entre stress vécu et état psychique)
- Chronologies croisées montrant le lien temporel entre les comportements et les effets
Témoignages, écrits, enregistrements : précautions légales
- Les enregistrements doivent respecter les lois (notamment sur le consentement selon les juridictions)
- Les témoignages doivent être datés, signés, crédibles
- Les pièces écrites doivent être conservées en version original
- Il faut éviter que le dossier paraisse “orienté vers la thèse” : chaque document doit être justifiable
4. Trois exemples fictifs concrets
Ces exemples visent à illustrer comment l’étiquette « pervers narcissique » peut compliquer ou polariser l’enquête, et comment revenir à la méthode factuelle.
Exemple professionnel
Sarah est assistante dans une entreprise. Elle dépose une plainte pour harcèlement moral contre son supérieur, Mr. L. Elle le qualifie de “PN” : “il me manipule, m’humilie, me ridiculise devant les collègues”.
L’entreprise mandate une enquête interne. Plusieurs difficultés apparaissent :
- Les RH, sensibles à l’argument “PN”, interprètent certaines critiques comme des “attaques verbales typiques du pervers narcissique”, sans écouter la version de Mr. L.
- Le supérieur, mis sur la défensive, adopte un ton agressif, ce qui est perçu comme “réaction classique d’un PN”.
- Finalement, l’enquête interne donne un avis partiel, faute de preuves solides, et renvoie les deux parties à une médiation (inefficace avec ce type de profil).
Si l’enquête avait été conduite de façon rigoureuse :
- Collecte des faits (emails, comptes-rendus, évaluations)
- Témoignages de collègues
- Chronologie des incidents
- Comparaison avec la charge de travail / consignes données
Le dossier aurait pu aboutir à une sanction ou un reclassement sans recourir à des interprétations psychologiques.
Exemple familial
Dans une fratrie, Léa accuse son frère Antoine (PN présumé) de harcèlement moral : reproches permanents, isolement des proches, culpabilisation. Elle saisit le juge aux affaires familiales dans le cadre d’un litige sur la succession.
L’avocate d’Antoine réplique que “PN” est un mot trop flou pour valoir preuve. Le juge demande des pièces concrètes : messages, témoignages, historique des relations, attestations psychologiques. Le dossier avance lentement.
Ici aussi, ce n’est pas « l’accusation PN » qui pèse, mais la consistance du dossier factuel qui décidera (et l’expertise psychologique, si elle est ordonnée).
Exemple de couple
Marie, en procédure de divorce, accuse son ex-conjoint, Paul, de harcèlement psychologique. Elle décrit un comportement manipulateur, des tentatives de “gaslighting”, des critiques constantes, un sentiment d’effacement de soi.
Paul, de son côté, nie être un PN, traite son ex de hystérique, accuse de manipulation réciproque.
Le juge demande une expertise psychologique, mais aussi les éléments : messages, témoins communs, bilans de santé, attestations proches. La mention “PN” fait florès dans les pièces mais ce sont les actes documentés qui pèseront.
Ces trois cas fictifs montrent que l’accusation de “PN” n’est un instrument utile que si elle vient en soutien d’un dossier argumenté.
5. Revenir à la nuance : quand invoquer la notion de PN ?
Plutôt que d’utiliser l’étiquette “PN” comme argument principal, mieux vaut la réserver au rôle de outil de compréhension, non d’accusation juridique.
Le rôle du discours manipulateur (terme du glossaire)
Le discours manipulateur est un terme plus précis, inscrit dans le glossaire de votre blog, qui permet d’identifier des stratégies (mensonges, inversion accusatoire, triangulation…). Il est moins “global” que “PN”, et plus utile en analyse. Utiliser ce terme dans l’enquête permet de repérer des mécanismes sans sombrer dans l’argument psychologique trop général.
Quand le terme sert la compréhension interne, mais pas l’enquête
Le terme de pervers narcissique peut avoir une valeur pédagogique — pour la victime, pour les proches, pour le récit personnel. Mais pour l’enquête, il doit être mis entre parenthèses. Le recours doit être limité à la dimension “modèle théorique explicatif”, et non comme pièce centrale de preuve.
Conseils pour garder le cap factuel
- Toujours faire la distinction entre le ressenti et les faits.
- Ne jamais présupposer la culpabilité psychologique sans preuve.
- Inviter les enquêteurs à rester dans la chronologie et la documentation.
- Lorsqu’un expert est saisi (psychologue, psychiatre), veiller à ce que son rapport soit circonscrit aux symptômes, sans jugement absolu.
6. Conclusion : sortir du mythe pour (re)faire la vérité juridique
L’expression « pervers narcissique » est puissante sur le plan émotionnel, car elle nomme une douleur, un vécu. Mais dans le cadre d’une enquête, elle est un serpent de mer — toujours relancée, souvent encombrante, rarement productive. L’article source rappelle que les enquêteurs doivent rester méfiants face à cette notion, pour revenir à l’analyse rigoureuse des faits.
Un de nos précédents articles, intitulé « Harcèlement moral au travail : quand le droit rejoint le vécu des victimes de profils toxiques » — rappelle que les victimes méritent d’être entendues, tout en rappelant la nécessité d’une méthode. Le terme « discours manipulateur » du glossaire permet d’ailleurs d’introduire ce concept technique sans sombrer dans l’illusion psychologisante.
Au final, c’est l’équilibre entre compréhension humaine et rigueur juridique qui permettra à une enquête de sortir du brouillard des accusations pour rejoindre la lumière de la preuve.
Avertissement : cet article est publié à des fins de sensibilisation uniquement. Il ne constitue en aucun cas un avis médical, psychologique ou juridique. Pour toute situation personnelle, il est essentiel de consulter un professionnel qualifié (avocat, thérapeute, médecin, etc.).