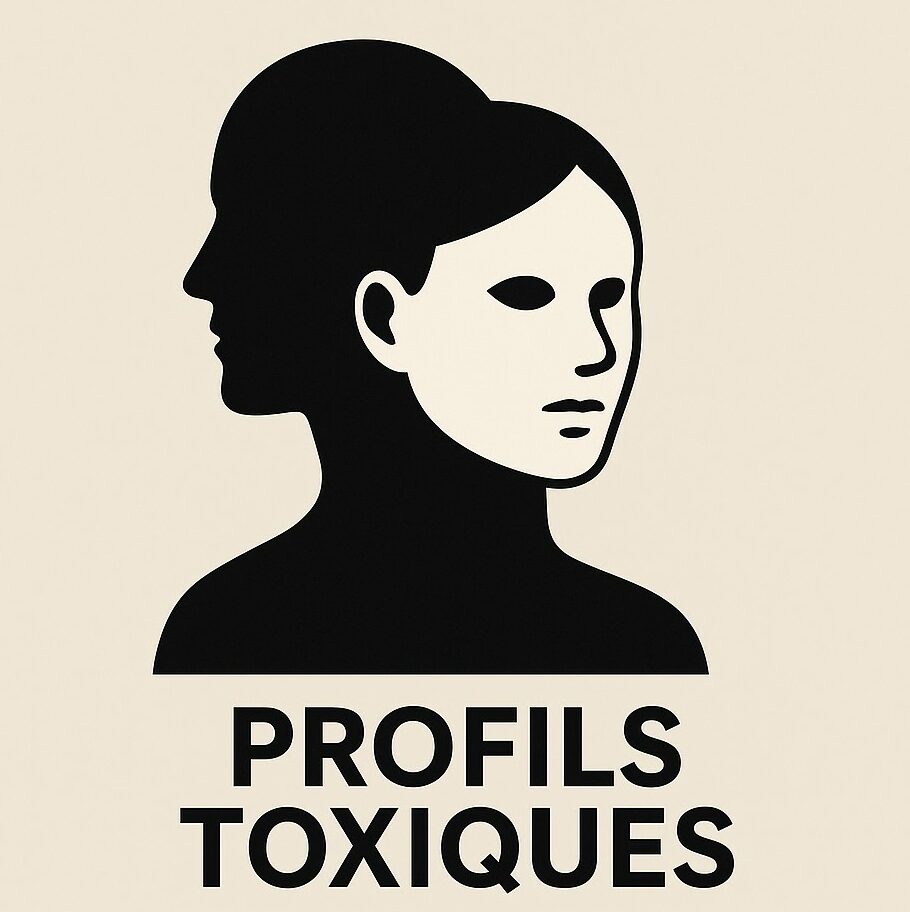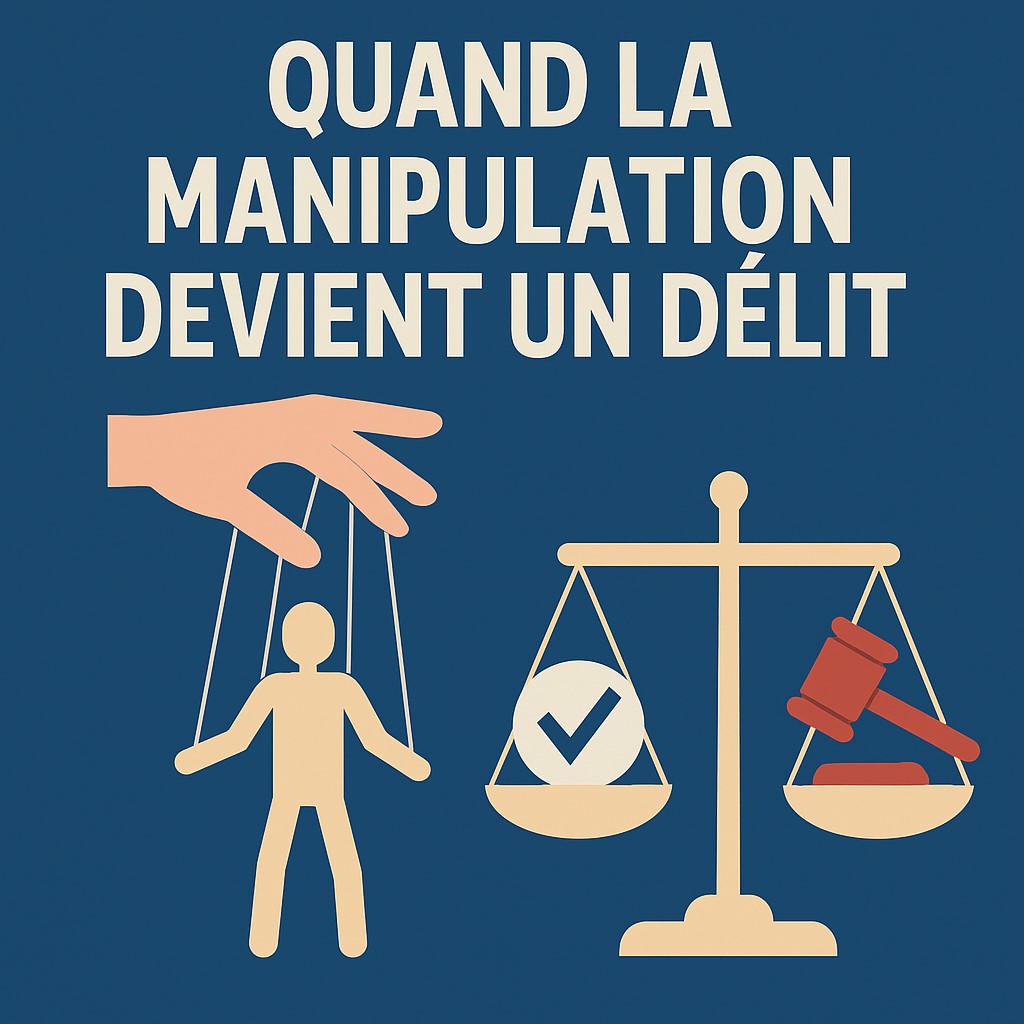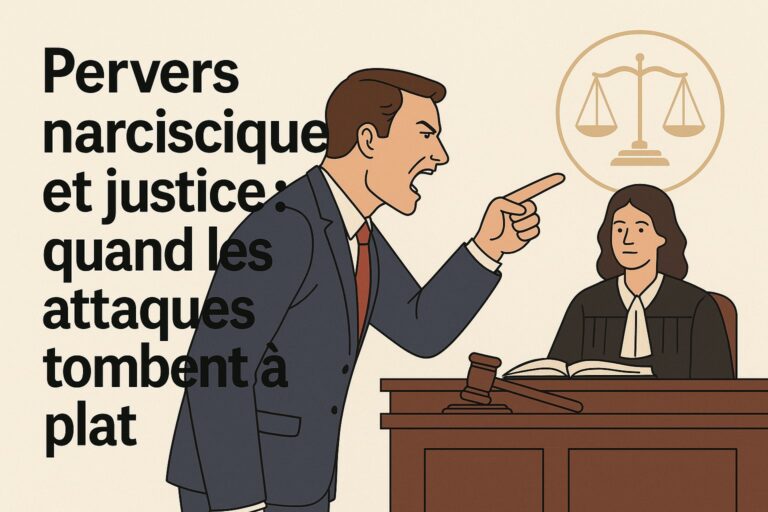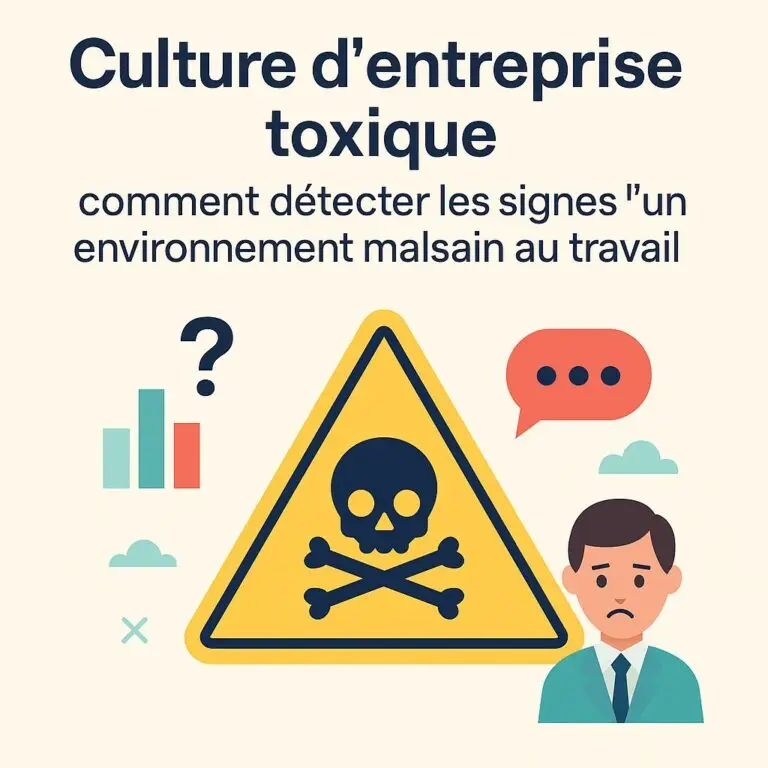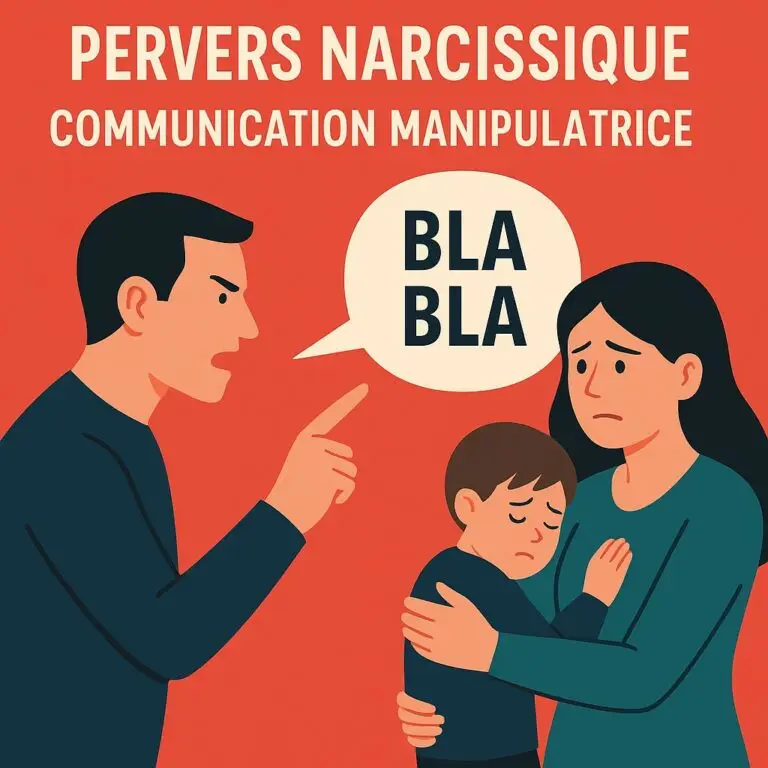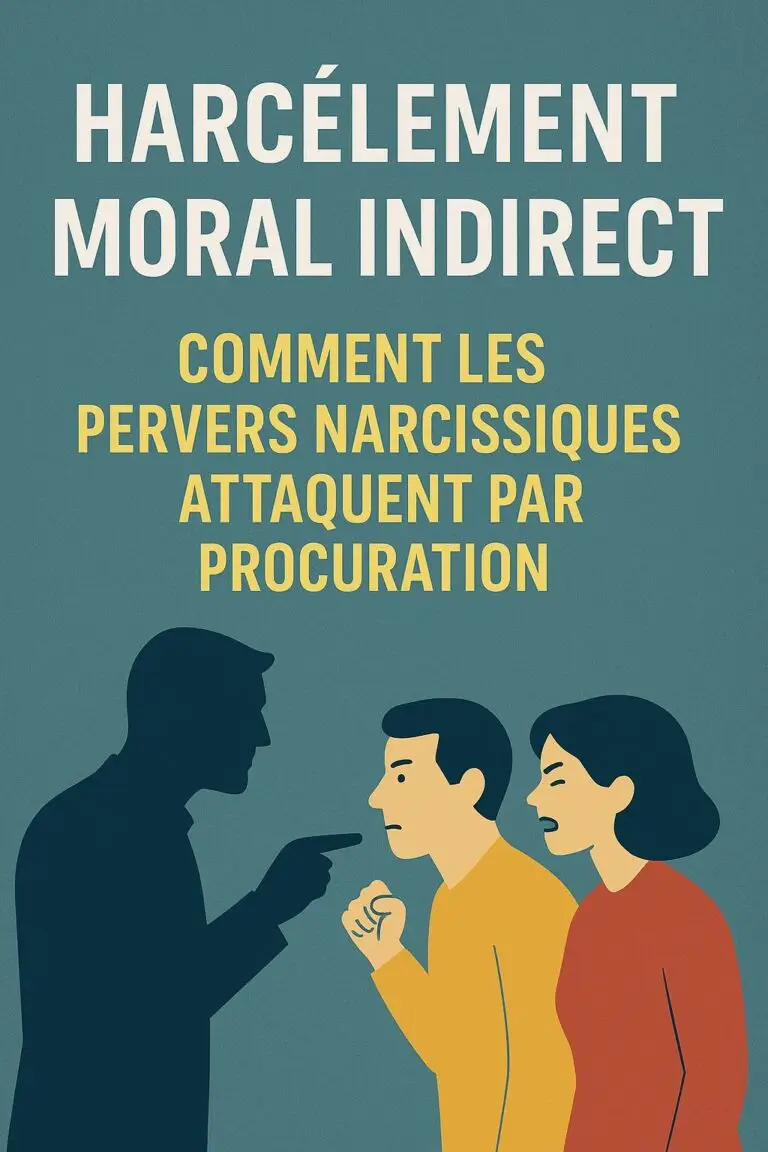Pervers Narcissiques : quand la manipulation devient un délit
Introduction
La manipulation psychologique, lorsqu’elle reste dans le domaine relationnel, peut passer inaperçue. Pourtant, elle peut évoluer vers une véritable infraction pénale. Cet article vise à éclairer les lignes de fracture : à quel moment la manipulation passe-t-elle du potentiel à la sanction ?
Nous aborderons : (1) les mécanismes de la manipulation et de l’« emprise » (et notamment du phénomène de « contrôle coercitif »), (2) le cadre juridique existant en France pour sanctionner ces comportements, (3) des exemples fictifs (contexte professionnel, familial, couple, parental) pour illustrer.
Nous ferons référence à l’article de Village Justice intitulé « La sanction du contrôle coercitif, une avancée dans la lutte contre les violences » et à la ressource de Marie‑France Hirigoyen « Cadre législatif des violences psychologiques dans le couple et dans la famille ». Nous y introduisons également un terme du glossaire du blog : « contrôle coercitif », que nous définirons et mobiliserons.
Comprendre la manipulation et le contrôle coercitif
Qu’est-ce que le contrôle coercitif ?
Le terme renvoie à une situation dans laquelle une personne réduit progressivement l’autonomie, la liberté d’action ou de pensée d’une autre, souvent au moyen de techniques de manipulation, d’isolement, de culpabilisation, de contrôle. Bien que ce terme ne soit pas nécessairement juridique, il permet de repérer l’état vécu par la victime d’un manipulateur.
Le passage de la manipulation à l’emprise et au contrôle coercitif
La manipulation mentale, selon les travaux de psychologie, ne se limite pas à un acte isolé : elle peut être gradualiste, cumulative. On parle alors d’un « flux » où la victime perd progressivement du terrain. Cette perte d’autonomie devient emprise et contrôle.
Le concept de contrôle coercitif
Le concept de « contrôle coercitif », comme défini dans le glossaire, est particulièrement pertinent pour comprendre quand la manipulation devient infraction : il s’agit d’un schéma comportemental répétitif et continu – – et non d’un incident isolé – dont l’objectif est de maintenir le pouvoir et le contrôle sur la victime.
Concrètement : « surveillance permanente, isolement social, contrôle économique, chantage émotionnel, menaces » sont autant de tactiques décrites.
L’article de Village Justice le décrit ainsi :
« Le contrôle coercitif se traduit par une accumulation d’actes qui visent à isoler, contrôler et intimider la victime : contrôler les liens de la victime avec son entourage, réduire son autonomie financière, surveiller ses activités quotidiennes, manipuler ses droits parentaux… »
Ce concept nous permet de passer de la notion vague de « manipulation » à celle de schéma de domination repérable.
Pourquoi la manipulation peut-elle devenir un délit ?
Les raisons d’une reconnaissance juridique
Plusieurs facteurs convergent :
- d’une part, la prise de conscience que les violences psychologiques — non seulement physiques — provoquent des dommages tout aussi graves (altération de la santé mentale ou physique).
- d’autre part, l’accumulation de faits apparemment anodins mais qui, mis bout à bout, dévoilent un système de soumission et privation de liberté. Le contrôle coercitif en est un bon exemple.
- de plus, la nécessité de protéger les victimes dans des domaines que le droit pénal ou civil couvrait mal jusque-là (ex : violences psychologiques, harcèlement conjugal).
Ainsi, on observe une progression du droit qui, dans certains pays, reconnaît explicitement ces schémas.
Le cadre législatif en France
Dans son article « Cadre législatif des violences psychologiques dans le couple et dans la famille », Marie-France Hirigoyen rappelle les étapes :
- l’article 222-13-6 du Code pénal (1994) reconnaît les violences commises au sein du couple.
- depuis 2004, diverses lois renforcent la protection du conjoint et élargissent les peines.
- la loi du 9 juillet 2010 a introduit le délit de violence psychologique pour le couple, défini comme « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale ».
Cependant, ce cadre reste fragmenté : le contrôle coercitif n’était pas encore expressément incriminé (jusqu’aux débats récents).
Par ailleurs, l’article de Village Justice note que la reconnaissance du contrôle coercitif en tant que tel constitue une « avancée dans la lutte contre les violences ».
Pourtant, sur le terrain judiciaire, les victimes de manipulation rencontrent encore d’importants obstacles. Les magistrats peinent parfois à saisir la dimension systémique de l’emprise, et la preuve reste difficile à établir. Comme nous l’avions analysé dans notre précédent article « Profils toxiques et pervers narcissiques face à la justice : des procédures impressionnantes… mais souvent creuses », le passage devant la justice peut même devenir un prolongement de l’emprise, lorsque le manipulateur utilise les procédures pour maintenir son pouvoir ou discréditer sa victime. Ce phénomène, qualifié de violence procédurale, illustre à quel point la manipulation peut s’étendre jusqu’à l’institution judiciaire elle-même.
Les conditions pour qu’il y ait délit
Pour qu’un comportement manipulatoire soit sanctionné, plusieurs critères devraient être remplis (via le prisme du contrôle coercitif) :
- Répétition et continuité des actes (ce ne sont pas des faits isolés) ;
- Objectif de domination ou de contrôle de la victime ;
- Diversité des tactiques (surveillance, isolement, pression, contrôle financier…) ;
- Atteinte aux droits fondamentaux de la victime : liberté, autonomie, santé mentale ou physique.
Quand ces éléments se trouvent cumulés, la manipulation n’est plus « simple conflit » mais bien une infraction potentielle.
Repérer les signaux : quand la manipulation franchit le seuil
Signes d’alerte généraux
Parmi les signaux qu’il convient de surveiller, on peut citer :
- isolement progressif de la victime (amis, famille, collègues) ;
- perte d’autonomie financière, dépendance économique ;
- contrôle des communications, des déplacements, des activités quotidiennes ;
- menaces, chantage, culpabilisation, humiliations répétées ;
- altération de la santé mentale ou physique de la victime (anxiété, dépression, perte de confiance…).
Si plusieurs de ces éléments sont présents et surtout s’inscrivent dans le temps, il peut s’agir d’un régime d’emprise.
Le virage vers le délit
Lorsque la situation s’installe, se complexifie et que l’auteur adopte un schéma de domination, la manipulation peut basculer en délit : l’instauration d’un état de peur ou de contrainte, l’atteinte aux libertés fondamentales. L’article de Village Justice précise :
« Le contrôle coercitif correspond à : “des propos ou comportements répétés ou multiples portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte…” »
Ainsi, le critère clé est la stratégie de contrôle, et non simplement la répétition : c’est bien un schéma global.
Quelques obstacles à la sanction
Même si le droit progresse, plusieurs freins persistent :
- la difficulté de preuve : les actes sont souvent diffus, apparemment anodins, isolés. La reconnaissance d’un schéma demande temps et témoignages.
- l’habitude de qualifier ces comportements comme « conflit de couple », ce qui minimise leur gravité.
- la méconnaissance de notions comme le contrôle coercitif chez les professionnels.
- la séparation de l’auteur et de la victime ne signifie pas toujours disparition de l’emprise : elle peut poursuivre via des tiers ou des procédures.
Quatre exemples fictifs
Exemple professionnel
Claire, cadre dans une entreprise, est sous l’emprise de son supérieur, Monsieur X. Au début, il valorise son travail, lui confie des missions importantes. Puis progressivement : il exige qu’elle réponde à ses SMS après 18 h, surveille ses déplacements, critique ses choix personnels, l’isole en lui enlevant le rôle de contact avec d’autres équipes, lui demande de ne pas informer ses collègues de ses horaires modifiés. Elle finit par se sentir mal, perd confiance en elle, et accepte des heures supplémentaires sans être payée.
C’est un modèle de manipulation qui mène à un schéma d’emprise psychologique. Si Monsieur X traite Claire de « nulle » devant ses pairs, l’accuse de ne pas être assez loyale, lui interdit de voir certains collègues, elle bascule dans un état où sa liberté professionnelle et personnelle est atteinte. S’il persistait dans ce schéma et que Claire devait prouver cette situation : cela pourrait relever d’un harcèlement moral ou pire d’un contrôle coercitif, si cela se réfère à l’atteinte aux libertés professionnelles et personnelles.
Cet exemple relie l’univers professionnel à notre thème : la manipulation n’est pas confinée aux situations familiales ou de couple.
Exemple familial
Jean est le fils unique d’un père — Monsieur P — qui organise la vie familiale selon ses règles. Il surveille les factures, impose au fils de rendre des comptes sur chaque sortie, le critique avec sa mère, l’insulte ou l’humilie s’il ne suit pas les instructions. Il restreint ses moyens (voiture, téléphone), l’empêche de voir certains amis, le culpabilise (« tu es ingrat », « tu devrais penser à moi ») et le tient responsable des tensions familiales. La mère est complice ou impuissante.
Jean se sent écrasé, ne sait plus s’il sort de sa chambre, perd confiance en lui. Ce schéma d’emprise familiale est manipulatoire. Si le père établissait une stratégie d’isolement, de contrôle, d’humiliation répétée, on pourrait envisager la notion de contrôle coercitif au sein de la famille. En effet, la loi et la doctrine reconnaissent que la violence psychologique ne se limite pas au couple mais s’étend à la famille.
Exemple de couple
Sophie et Alexandre sont en couple depuis deux ans. Au début, tout va bien : Alexandre est charmant, attentif. Puis il commence à lui dire ce qu’elle doit porter, à contrôler ses comptes en banque, à demander les identifiants de ses réseaux sociaux, à l’appeler toutes les heures sous prétexte qu’il s’inquiète. Il lui interdit de voir certaines amies, critique ses prestations au travail, la compare à ses ex. Petite à petite, Sophie perd son estime de soi. Elle finit par se demander si elle est « anormale ». Elle souffre d’anxiété et de troubles du sommeil.
Puis, à la maison, il l’isole davantage : il éteint la lumière quand elle monte l’escalier, lui intime l’ordre de ne rien dire aux enfants de ses doutes. Ce schéma est exactement celui décrit dans l’article de Village Justice : « la femme sous emprise se trouve enfermée, isolée dans un cercle… ».
Si Alexandra utilisait la menace de « tu ne pourras plus voir les enfants » ou l’interdiction d’ouvrir un compte bancaire sans son accord, il s’agirait d’actes relevant de la stratégie de contrôle coercitif. Une fois repéré, cela peut autoriser des moyens de protection (procédures, éviction, sanctions pénales ou civiles). Le seuil d’infraction peut alors être franchi.
Exemple de couple parental avec un parent manipulateur
Élodie et Marc sont séparés depuis trois ans. Ils ont une fille, Camille, huit ans. Durant leur vie commune, Marc contrôlait déjà tout : dépenses, emploi du temps, relations. Après la séparation, l’emprise se poursuit : il impose ses décisions de garde, critique Élodie devant l’enfant (« ta mère exagère »), et la dénigre auprès de l’école.
Élodie vit dans la peur constante des reproches et des menaces judiciaires. Camille, instrumentalisée, répète les paroles du père et développe anxiété et confusion. Ce schéma illustre une violence psychologique indirecte, où le parent manipulateur maintient son pouvoir à travers l’enfant et le cadre parental.
Dans ce type de cas, la manipulation dépasse le simple conflit parental : elle devient un contrôle coercitif post-séparation, pouvant relever du délit de violences psychologiques lorsque la santé mentale du parent et de l’enfant est altérée.
Que faire ? Repères pratiques pour agir
Pour la victime
- Nommer ce qui se passe : reconnaître que l’on est sous emprise, que la manipulation n’est plus « juste » un conflit ou une crise.
- Recenser les faits : tenir un journal (dates, actes, témoins, messages) aide à faire émerger le schéma. Cela est aussi évoqué dans les travaux sur le contrôle coercitif : la juge recommande de « tenir une liste ou de récapituler par des SMS chaque fait » pour les victimes.
- S’entourer : famille, amis, associations spécialisées. Le silence ou l’isolement renforcent l’emprise.
- Consulter des professionnels : avocat, psychologue, service d’aide aux victimes. Le repérage précoce est souvent un facteur clé.
- Mesures de protection : dans le cadre conjugal ou familial, des dispositifs d’éviction de l’auteur violent du domicile existent, de même que des mesures d’urgence dans le Code pénal.
Pour les professionnels (avocats, psychologues, RH…)
- Se former aux notions d’emprise, de contrôle coercitif : ces termes ne sont pas toujours connus en justice ou en entreprise.
- Adopter une lecture systémique : ne pas isoler un seul incident mais repérer une stratégie de domination.
- Documenter la preuve : constituer un faisceau d’indices, qui montre la continuité et la répétition des comportements.
- Orienter les victimes vers des structures spécialisées.
- Mettre en place des politiques internes (dans les entreprises) contre le harcèlement moral, la manipulation.
Limites et vigilance critique
- Le terme « manipulation » reste vaste et peut être galvaudé : tous les conflits ne sont pas des délits.
- Il convient de ne pas tout interpréter comme contrôle coercitif : la réalité juridique exige des critères précis (répétition, schéma de domination, atteinte aux libertés).
- Un risque de réification abusive : qualifier toute relation difficile de « pervers narcissique » ou d’« emprise » peut détourner l’attention de la réalité des faits. Comme l’indique une source, bien que le terme « pervers narcissique » soit largement diffusé, il n’est pas institutionnalisé dans les classifications psychiatriques.
- La preuve reste difficile : les actes sont souvent subtils, invisibles, et la victime peut être isolée ou dissuadée de témoigner.
Vers un avenir juridique : la reconnaissance du contrôle coercitif comme délit autonome
La reconnaissance explicite du « contrôle coercitif » comme infraction autonome en droit français est en débat. Un article récent (Le Monde, mars 2025) explique que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi créant ce délit.
Cette évolution montre que la manipulation ne sera plus vue uniquement comme un ensemble d’actes isolés, mais comme un système complexe passible de sanctions.
L’article de Village Justice en date du 24 mars 2025 souligne que « la sanction du contrôle coercitif » constitue une avancée dans la lutte contre les violences.
Cette perspective offre un espoir pour les victimes : un cadre plus clair, une reconnaissance juridique accrue, un signal social fort.
Conclusion
Quand la manipulation devient un délit : ce seuil existe, et il s’appuie sur une logique de domination, non plus sur un simple conflit. La reconnaissance du phénomène passe par la qualité d’emprise de la victime, la stratégie répétée de l’auteur, et l’atteinte aux libertés fondamentales. Le droit français évolue, mais la vigilance, la formation, et l’accompagnement des victimes restent indispensables. Dans un contexte professionnel, familial ou amoureux, repérer à temps ces schémas peut faire la différence entre une souffrance silencieuse et une prise en charge adaptée.
Avertissement : cet article est publié à des fins de sensibilisation uniquement. Il ne constitue en aucun cas un avis médical, psychologique ou juridique. Pour toute situation personnelle, il est essentiel de consulter un professionnel qualifié (avocat, thérapeute, médecin, etc.).