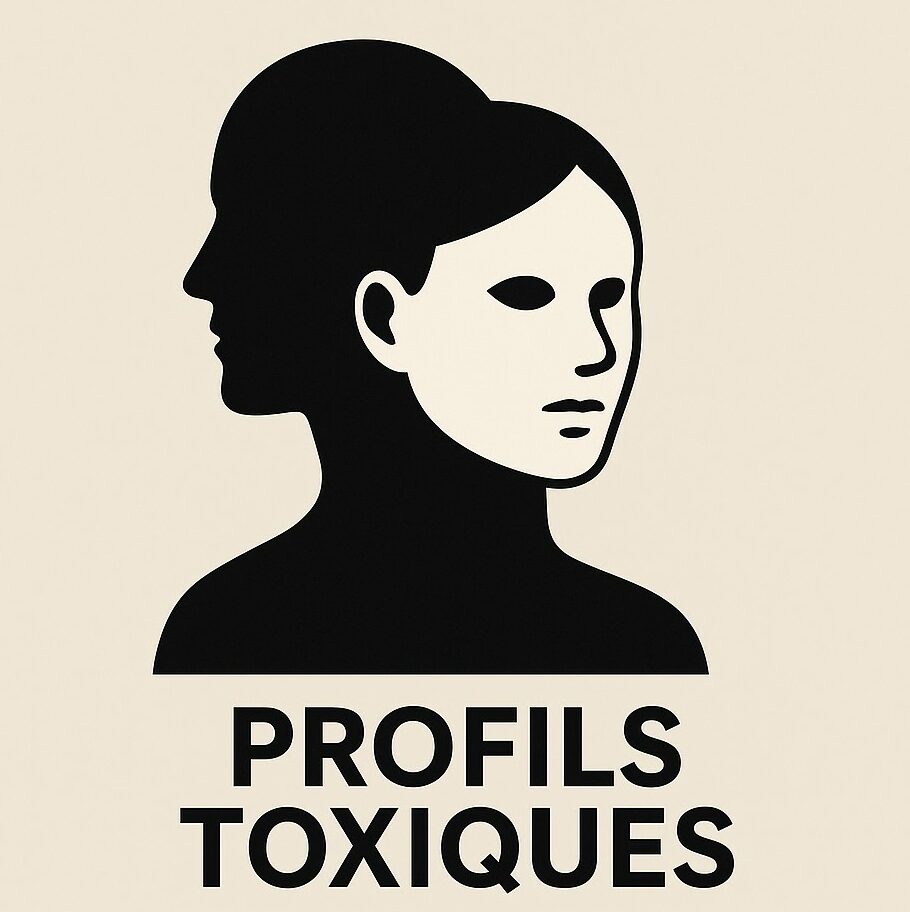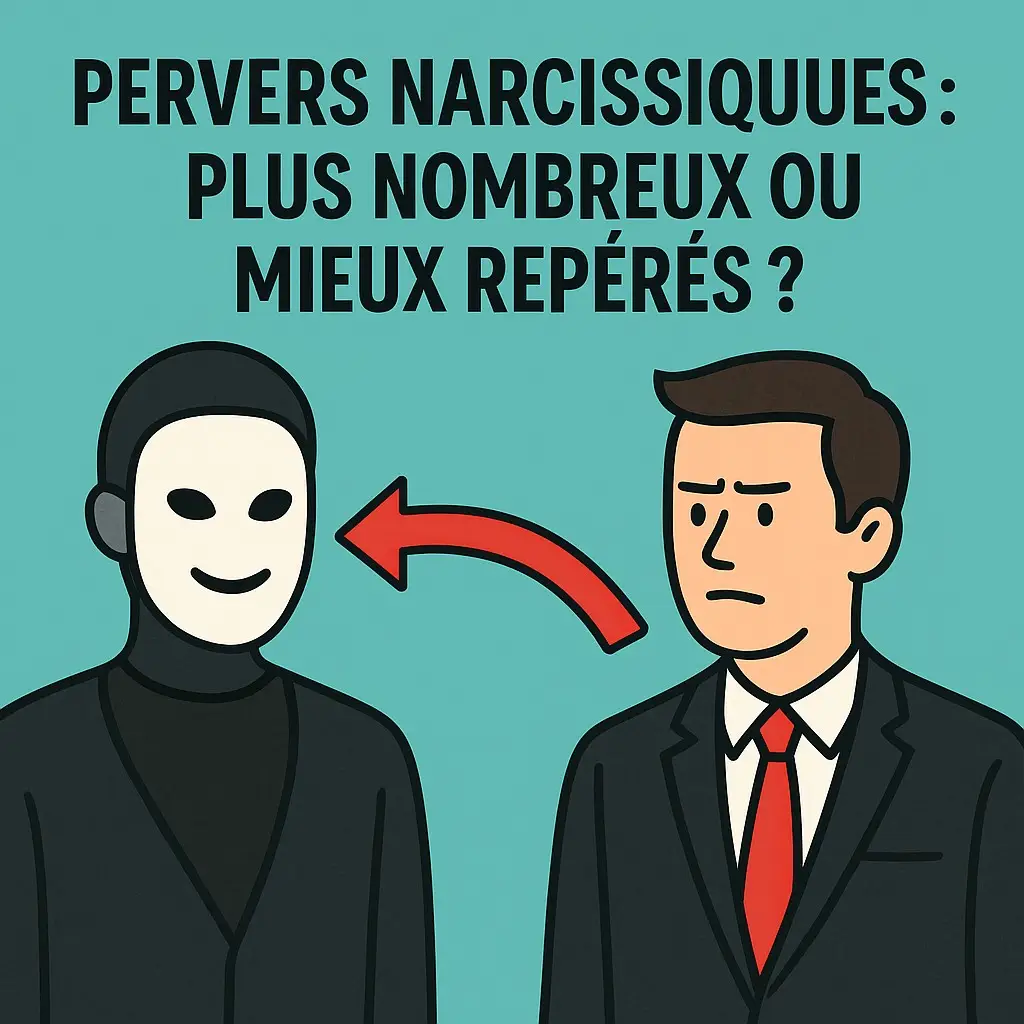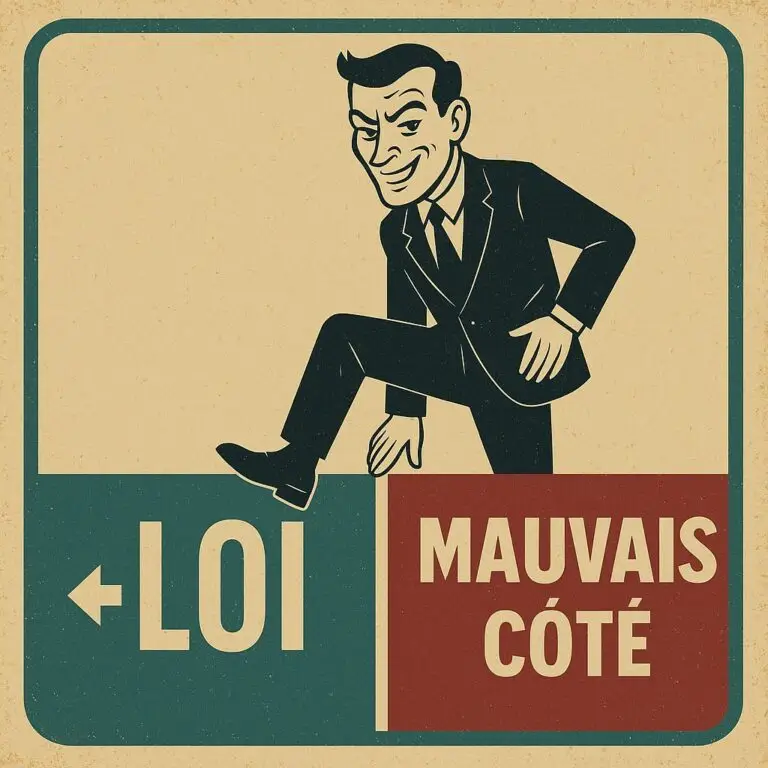Pervers narcissiques : sommes-nous plus nombreux à en souffrir… ou simplement les repérons-nous mieux ?
Depuis quelques années, le terme « pervers narcissique » s’est emparé du langage courant. On le voit sur les réseaux, dans les livres, au tribunal, dans les consultations. Cette progression soulève légitimement la question : la société en est-elle confrontée davantage, ou est-ce l’effet d’une meilleure reconnaissance ?
La lecture psychologique d’Alexandra Rivière
Sur son blog, Alexandra Rivière, psychologue intégrative, publie un article intitulé « La banalité du mal ou quand le narcissisme envahit la société ». Elle y explique :
- Que le narcissisme pathologique n’est pas un phénomène nouveau, mais que sa formulation s’est propagée parce que notre société, centrée sur l’ego, le favorise.
- Elle parle de la banalité du mal : des comportements toxiques quotidiennes qui se déguisent en choix normaux, comme l’émulation permanente, la survalorisation des apparences, la compétitivité exacerbée.
- Elle insiste sur l’idée que, plus que l’augmentation des PN, c’est leur visibilité qui croît. En nommant et décrivant leurs mécanismes, on donne forme à ce qui était passé sous silence.
Cette approche invite à se demander si le problème réside dans plus de pervers narcissiques, ou dans plus de mots pour les encapsuler.
Deux dynamiques à distinguer
Une société qui favorise l’égo
Les pervers narcissiques existent et exploitent le contexte :
- Individualisme, réseaux sociaux, quête d’image : notre environnement valorise l’apparence, la réussite immédiate, et donne un terreau fertile à l’émergence de traits narcissiques extrêmes.
- Évolution technologique : les trolls et harcèlements en ligne montrent comment le PN peut s’exercer à distance, amplifié par des relais numériques.
- Carence des systèmes protecteurs : divorce avec médiation, hiérarchies laxistes en entreprise, faible encadrement parental ajoutent à l’isolement de la victime, favorable à l’emprise.
Ces éléments amplifient la probabilité que des profils toxiques exploitent le chaos ambiant pour exercer leur domination.
Un vocabulaire partagé par les victimes
- Démocratisation de la psychologie : podcasts, blogs, réseaux sociaux permettent à chacun d’accéder à un vocabulaire clinique (PN, narcissisme, emprise, TCC).
- Formation des professionnels : avocats, surveillants du travail, thérapeutes ont des outils plus pertinents pour déceler subtilement le harcèlement moral.
- Médiatisation de témoignages : récits de victimes, émissions, articles contribuent à cette sensibilisation.
En bref : le bouillon narcissique est peut‑être le même, mais notre œil est plus averti.
Une culture narcissique qui s’installe
Alexandra Rivière situe le PN dans un cadre sociétal : la culture de l’individualisme et de la performance permanente crée un terrain favorable à ces personnalités destructrices. Ce terrain nourrit deux processus :
- La normalisation de l’emprise : lorsque les gens sont constamment évalués (au travail, en famille, sur Instagram), la manipulation devient un outil courant pour atteindre un but ou se protéger.
- La banalisation du mal narcissique : au quotidien, on tolère des comportements blessants (la critique gratuite, la dérision, la pression morale) sans se rendre compte qu’il s’agit parfois de prémices de relations toxiques.
Ainsi, ce qui émerge comme nouveau n’est souvent qu’une exposition accélérée de pratiques déjà ancrées.
Mieux repérer, mieux encadrer
Comprendre les signaux faibles
Ce recul critique permet de passer d’une culpabilisation à une prise de pouvoir :
Détection plus fine : Les victimes peuvent reconnaître des signes comme l’inversion accusatoire, le triangle de Karpman, ou le harcèlement par procuration – des techniques que l’on ne connaissait pas ou ignorait avant. Voir aussi notre article : Le Triangle de Karpman : comprendre les relations toxiques et les pervers narcissiques.
Le rôle de la loi et des avocats
Formalisation juridique : Les avocats travaillent sur des cas de harcèlement moral indirect, regroupés sous la forme de dossiers cohérents (ex. : collectes d’emails, attestations, notes de réunions).
Responsabiliser les structures
Protection institutionnelle : Entreprise, école, famille peuvent réagir, notamment par la prise de conscience des mécanismes d’emprise.
Attention au surdiagnostic
Mais l’excès d’accréditation du concept n’est pas sans danger :
- Tout conflit n’est pas un PN : certaines personnes sont difficiles, d’autres dysfonctionnelles, mais ne relèvent pas du même niveau pathologique.
- Danger de récupération juridique : évoquer un PN dans un dossier sans objectifs clairs peut diluer la crédibilité.
- Risque d’étiquetage social : crier « pervers narcissique » sur les réseaux ou dans une dispute enlève toute nuance et fragilisation la réponse empathique nécessaire pour aider réellement.
On doit donc être vigilant : le repérage n’est utile que s’il ouvre la voie à un changement, et non à l’ostracisation.
Le futur : vers une ère de conscience empathique ?
L’enjeu éducatif et social
Si les pervers narcissiques étaient capables de dissimulation, l’apparition de ce terme dans notre vocabulaire global marque la prise de conscience. Il nécessite notamment l’intégration de la psycho-juridique en formation professionnelle.
Un chantier judiciaire en devenir
Comment réguler le narcissisme universel, pour empêcher qu’il ne plonge dans la perversion psychologique ?
Conclusion
Alors : y a‑t‑il plus de pervers narcissiques aujourd’hui ?
La réponse pourrait être : oui… et non.
Oui, parce que la culture de l’individualisme exacerbé crée un terrain propice.
Non, parce que nous disposons désormais d’outils verbaux, normatifs et collectifs pour les identifier.
Derrière ces deux dynamiques, le plus important reste : ne pas en rester à une posture de victime, mais agir, nommer, et se protéger.
Ce n’est qu’à ce prix que l’on transformera une société potentiellement toxique en une collectivité consciente, résiliente et bienveillante.
Mais cette prise de conscience collective ne peut suffire. L’étape à venir, cruciale, consistera à réfléchir à comment notre société, et en particulier notre système judiciaire, peut mieux gérer ces bourreaux, sans les banaliser, et entendre plus justement les victimes, sans les réduire à leur souffrance. Car repérer ne suffit pas : il faut aussi agir, encadrer, et réparer.
Avertissement : cet article est publié à des fins de sensibilisation uniquement. Il ne constitue en aucun cas un avis médical, psychologique ou juridique. Pour toute situation personnelle, il est essentiel de consulter un professionnel qualifié (avocat, thérapeute, médecin, etc.).