La jouissance de la transgression : entre perversion narcissique et confusion des repères
Il est des comportements qui, à première vue, semblent absurdes, contre-productifs ou même injustifiables. Pourtant, pour certains profils dits « toxiques », ces actes sont au cœur d’un fonctionnement psychique bien plus profond : la jouissance de la transgression. Cette dynamique est particulièrement visible chez ce qu’on appelle couramment le « pervers narcissique », une figure qui, au-delà de son apparente maîtrise, prend un réel plaisir à contourner les règles, à imposer un rapport de force, et à jouer avec les limites de l’autre – et parfois même avec les structures sociales.
Le plaisir de l’interdit : une dynamique bien connue
Dans la littérature psychanalytique, la notion de transgression n’est pas nouvelle. Elle est souvent liée à la question du surmoi et à sa mise en échec. Le pervers narcissique, pour reprendre la typologie exposée par Paul-Claude Racamier, détourne les interdits non pas dans une recherche de liberté mais dans une stratégie de domination. Il s’agit de montrer que rien ne l’arrête, ni la loi, ni l’éthique, ni même le bon sens. Ce plaisir n’est pas anodin : il s’inscrit dans une volonté de provoquer, de désorienter et d’imposer un pouvoir.
Exemple familial : tatouer une fillette… par surprise
Prenons une situation réelle dans le cadre d’une séparation parentale conflictuelle. Un père, en garde alternée, reçoit un message de la mère de sa fille de 9 ans alors qu’elle est en route pour un salon de tatouage. Elle l’informe, sur le ton du fait accompli, qu’elle va faire tatouer l’enfant – non pas un vrai tatouage indélébile, mais un « tatouage temporaire » professionnel présenté comme une « expérience », sans en avoir jamais discuté auparavant.
Elle justifie cette décision de dernière minute en disant que l’enfant aurait exprimé ce désir depuis longtemps. Le père, pris de court, tente de s’opposer au geste et surtout à la méthode : pourquoi un tel manque de concertation sur une activité si symbolique ? Pourquoi cet acte soudain ? Son objection est ignorée, et le tatouage est réalisé.
Une semaine plus tard, lorsqu’il récupère sa fille, elle lui avoue en toute simplicité qu’elle n’avait rien demandé avec insistance – que sa mère avait eu « l’idée comme ça, ce matin-là ».
Ce qui frappe ici, au-delà de l’acte lui-même, plutôt bénin en apparence, c’est le mode opératoire. La décision est prise unilatéralement, au dernier moment, sans discussion, en invoquant l’enfant comme alibi. Ce type de comportement met en lumière la logique de la transgression : déjouer les attentes, briser les cadres du dialogue parental, et montrer qu’on peut tout faire, même dans ce qui devrait rester un espace de codécision.
Jouissance de la transgression à grande échelle : l’exemple politique
Cette mécanique de transgression peut-elle se manifester au sommet de l’État ? Poser la question n’est pas y répondre, mais elle mérite d’être soulevée. En juin 2024, le président Emmanuel Macron annonçait, à la surprise générale, la dissolution de l’Assemblée Nationale. Une décision vraisemblablement prise sans véritable concertation ni consultation, dans un moment de tension électorale maximale.
Nombreux ont été les observateurs, politologues comme citoyens, à se demander : s’agissait-il d’un calcul stratégique ou d’un acte de rupture « limite » ? Une volonté de reprendre la main ou une forme de « passage en force » et « coup de théâtre », aux allures de la transgression institutionnelle ?
L’acte interroge surtout quant à sa dimension symbolique : que dit-il de cette posture de pouvoir ? D’un certain rapport à la règle, au processus, et à l’imprévisibilité ?
Pourquoi cette jouissance de transgresser ?
La psychanalyste Marie-France Hirigoyen, dans ses travaux sur le harcèlement moral, évoque cette dynamique chez les personnalités perverses : « Ils savent ce qu’ils font, mais refusent d’en assumer la responsabilité. Ce qu’ils cherchent, c’est à pousser l’autre à la faute, à le déstabiliser pour garder le contrôle. »
La transgression devient alors une arme psychologique. Elle permet au pervers narcissique d’affirmer un pouvoir qui se nourrit du déséquilibre qu’il crée autour de lui. En mettant les autres devant le fait accompli, il nie leur capacité d’agir, de réagir, ou même de penser clairement.
Comment réagir face à cela ?
Le plus difficile, face à une telle jouissance de la transgression, est qu’elle dépasse la logique rationnelle. Tenter de convaincre ou de raisonner revient souvent à tomber dans un piège soigneusement tendu. La meilleure réponse reste souvent de poser des limites fermes, de documenter les faits, et de chercher un appui extérieur – que ce soit psychologique, juridique ou institutionnel.
Car en fin de compte, reconnaître cette dynamique, c’est reprendre une forme de pouvoir sur soi-même : celui de ne plus être dupe.
Pour aller plus loin
Un article accessible gratuitement en ligne propose une lecture éclairante sur cette dynamique : « La jouissance à faire le mal dans la perversion narcissique » (site Psychothérapie Calonne). Il explore le plaisir que certains individus tirent consciemment du mal qu’ils causent, et comment ce mécanisme s’articule autour de la manipulation, de la domination et de la perte de repères chez l’autre.
Ressources complémentaires
- Les nouvelles souffrances au travail, Marie-France Hirigoyen, éd. Le Seuil
- Le pervers narcissique et son complice, Jean-Charles Bouchoux, éd. Eyrolles
- Le génie des origines, Paul-Claude Racamier, éd. Dunod
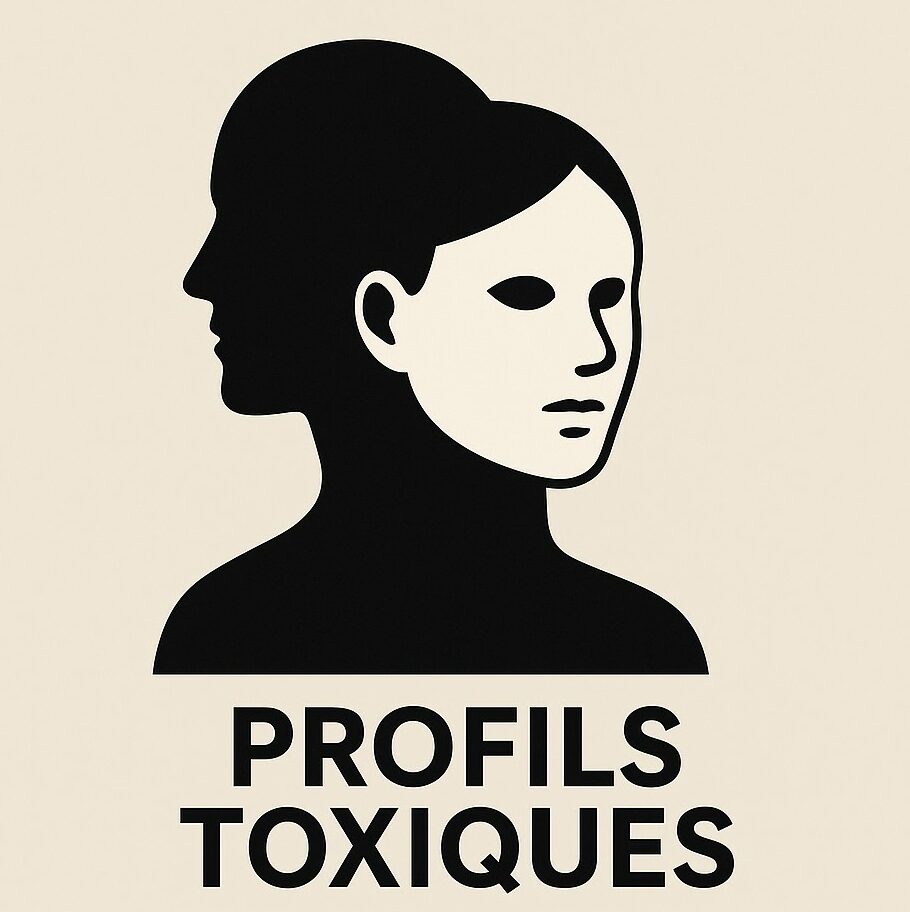

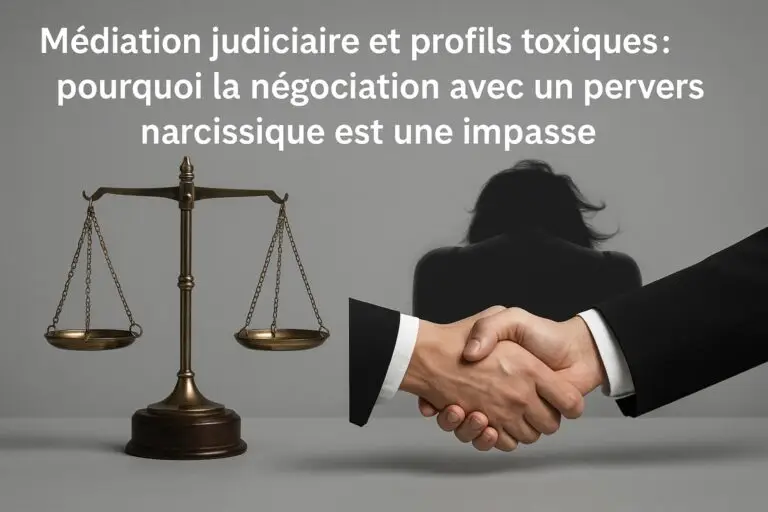

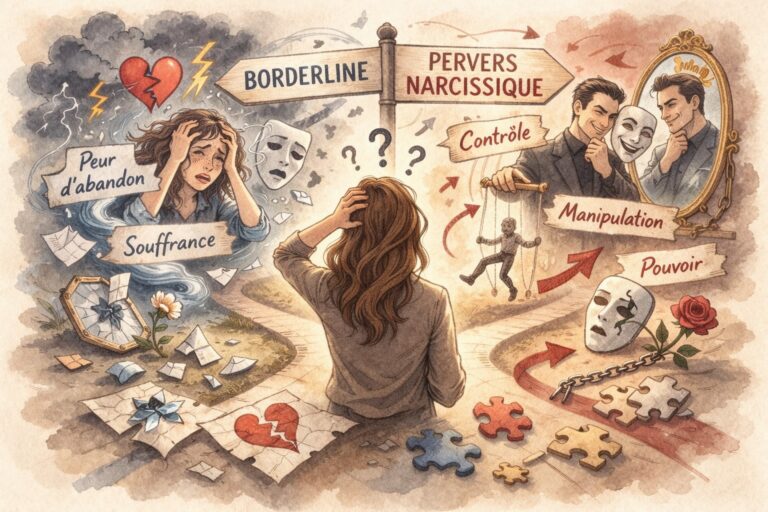



Un commentaire